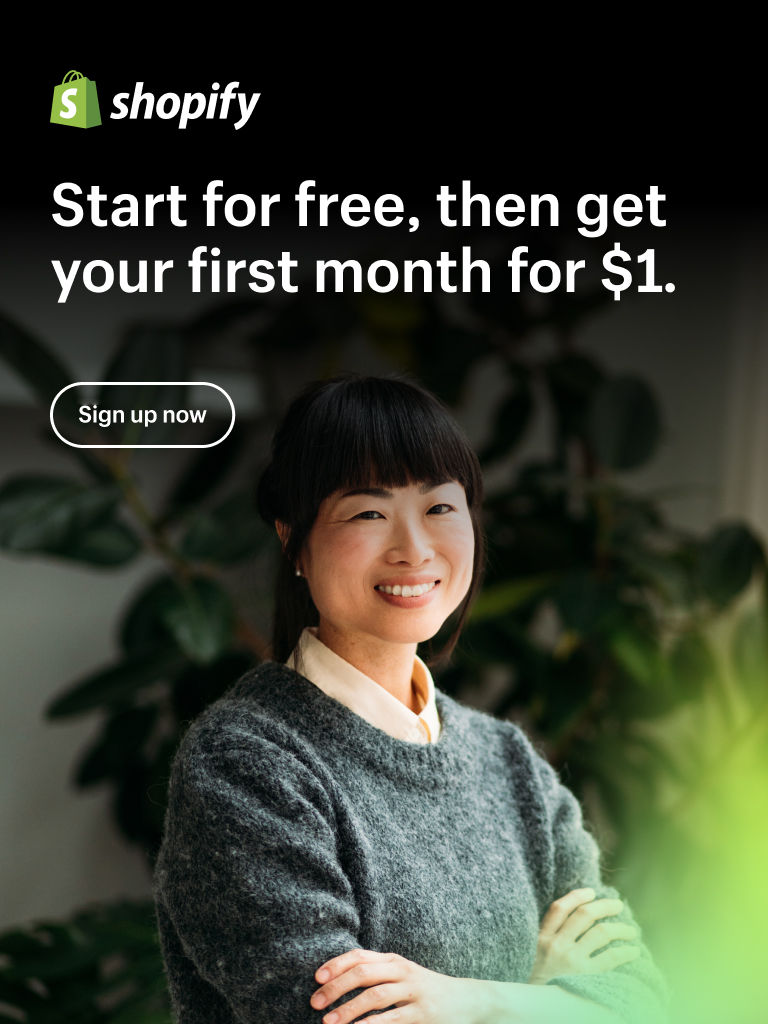Défi physiologique : l'hypoxie en altitude
L'ascension à des altitudes élevées représente un énorme défi pour notre organisme. défi physiologique. Plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique diminue. pression barométrique et donc aussi la pression partielle d'oxygène (pO2). Cet état est appelé Hypoxie désigne un manque d'oxygène dans les tissus. Pour faire face à ce défi, le corps active une cascade complexe de mécanismes d'adaptation.

Phase aiguë : réaction rapide du corps
Durant les premières heures en montagne, le corps réagit par des mécanismes compensatoires immédiats :
-
l'hyperventilation : Les chémorécepteurs dans la crosse de l'aorte et la carotide enregistrent la baisse de
pO2
et stimulent le centre respiratoire dans le cerveau. Cela entraîne une augmentation de la fréquence et de la profondeur de la respiration afin de maximiser l'absorption d'oxygène par les poumons. - Réponse cardiaque : Le débit cardiaque est augmenté par une augmentation de la fréquence cardiaque afin d'acheminer plus rapidement l'oxygène circulant vers les tissus périphériques.
- Déplacement des liquides : Le corps transfère de l'eau du intravasculaire (plasma sanguin) vers l'espace espace extravasculairece qui entraîne une augmentation temporaire hémoconcentration et la concentration relative des érythrocytes (globules rouges).
Acclimatation : ajustements structurels à long terme
Après quelques jours, le processus de acclimatation, une profonde restructuration physiologique:
- l'érythropoïèse: En réponse à l'hypoxie, les reins sécrètent davantage l'hormone érythropoïétine (EPO) de l'hémoglobine. Cela stimule la hématopoïèse dans la moelle osseuse, ce qui entraîne une production accrue de érythrocytes ce qui entraîne une augmentation de la production d'érythrocytes. Une augmentation de la de l'hématocrite et de la concentration en hémoglobine améliore la capacité de transport de l'oxygène du sang de manière significative.
- l'angiogenèse : Dans le tissu musculaire, il se produit une capillarisation - la formation de nouveaux capillaires. Cela raccourcit la distance de diffusion de l'oxygène entre les vaisseaux sanguins et les myocytes. Myocytes (cellules musculaires).
- Niveau cellulaire : La densité des Mitochondries, les "centrales électriques" des cellules, augmente. En outre, l'efficacité de la extraction de l'oxygène du sang est améliorée, ce qui permet une production d'énergie aérobie permet d'obtenir des résultats.
Ces ajustements sont déterminants pour la performance. Une soigneuse stratégie d'acclimatation minimise le risque d'un mal aigu des montagnes et permet à l'organisme de tirer pleinement parti des avantages physiologiques de l'adaptation à l'altitude.

Sommeil en montagne - Pourquoi la régénération nocturne fonctionne-t-elle différemment à 2.000 mètres d'altitude ?
L'influence de l'altitude sur le sommeil
Le sommeil est l'une des phases de régénération les plus importantes pour les alpinistes. Mais en altitude, le modèle de sommeil change considérablement. L'hypoxie entraîne des réactions de réveil plus fréquentes, une réduction de la part de sommeil profond et parfois même une respiration périodique pendant la nuit. Ces facteurs peuvent avoir un impact considérable sur la récupération physique et mentale.

Stratégies pour un meilleur sommeil dans les régions alpines
Une bonne hygiène de sommeil est donc particulièrement importante : hydratation adaptée, repas et micronutriments avant le sommeil, vêtements suffisamment chauds et absence d'alcool et de caféine. Une acclimatation progressive réduit également la probabilité de troubles du sommeil. En veillant à un sommeil suffisant et de qualité, on crée les bases d'une meilleure régénération, d'un système immunitaire fort et de performances durables en montagne.
Auteur : Laura Bahmann
Sources :
- Ouest, J. B. (2012). Médecine et physiologie de haute altitude. Oxford University Press.
- Levine, B. D., & Stray-Gundersen, J. (1997). "Living high-training low" : effet de l'acclimatation à l'altitude avec une exposition intermittente à l'hypoxie sur l'entraînement et la performance athlétique.. Journal of Applied Physiology, 83(1), 102-112.
- Pugh, L. G. C. E. (1962). Aspects physiologiques et médicaux de l' expédition scientifique et d'alpinisme de 1960-61 dans l'Himalaya.. British Medical Journal, 2(5318), 1362.